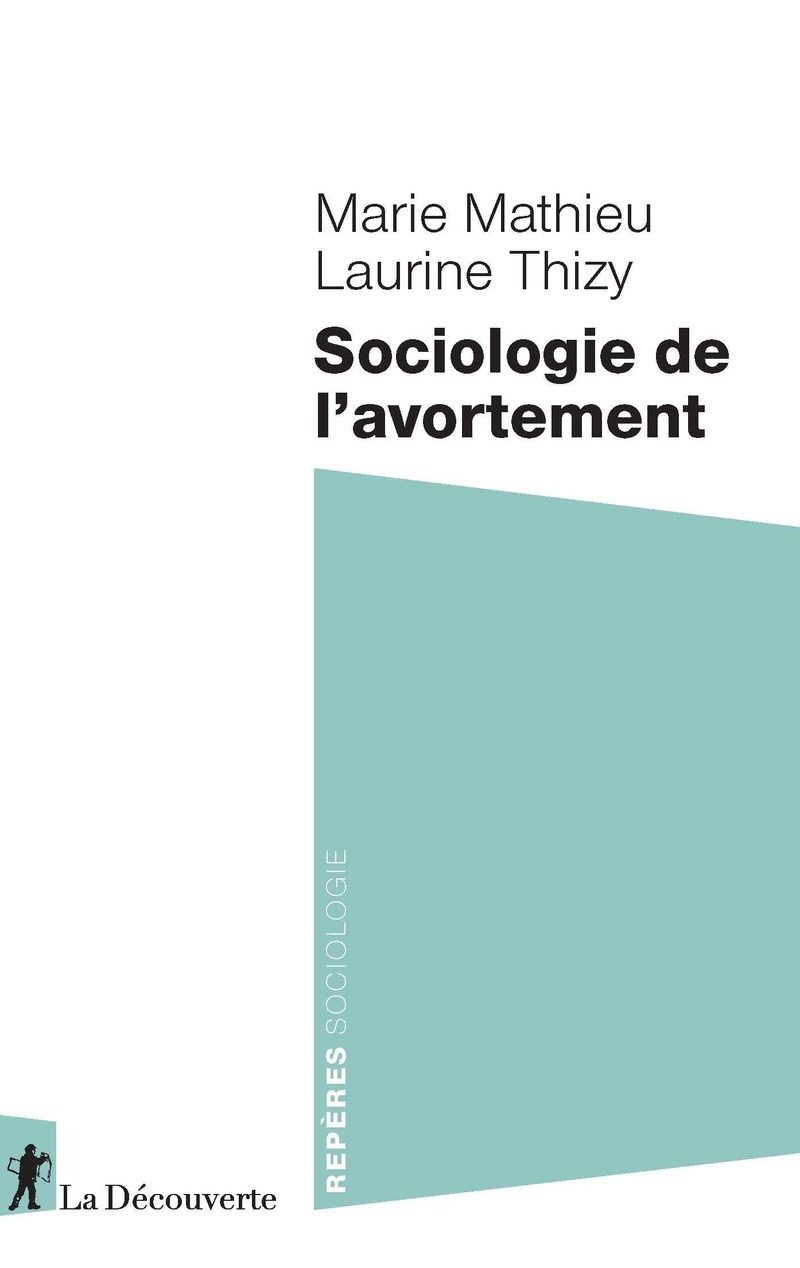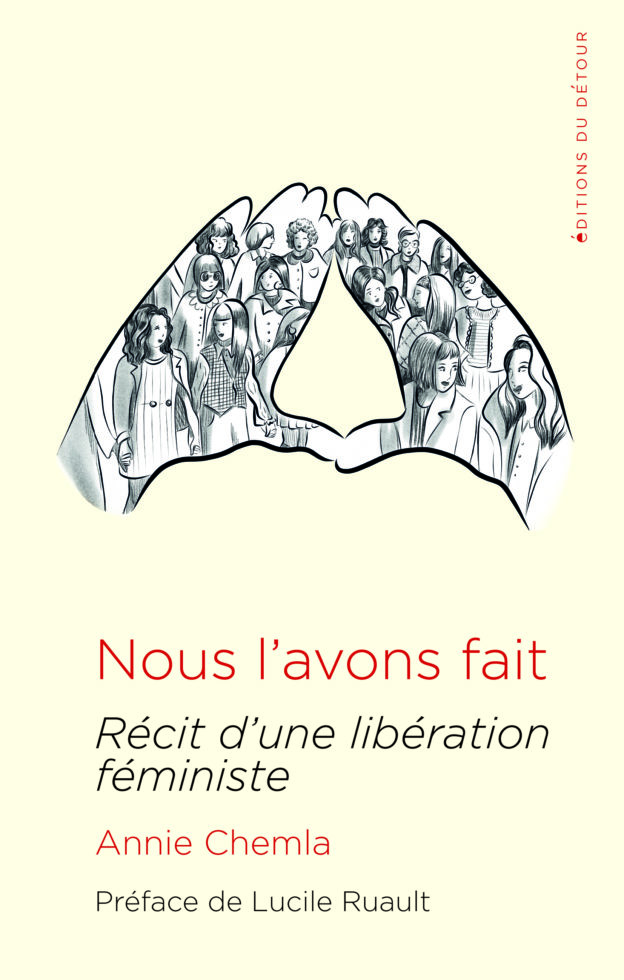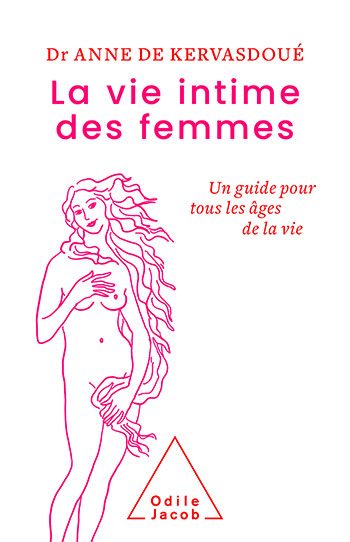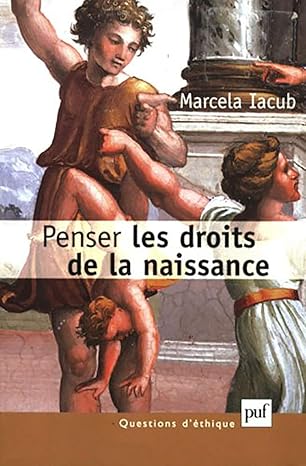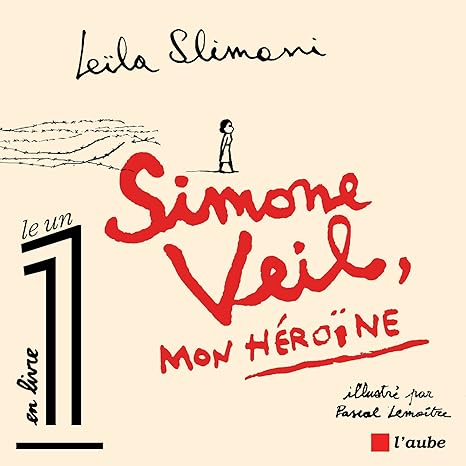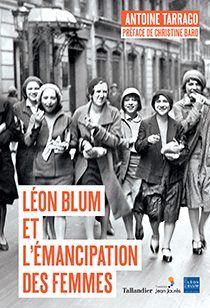Loi Veil et avortement : nos ressources numériques
Découvrez notre sélection de ressources numériques autour de la loi Veil et de l’avortement, à consulter à la Bpi ou de chez vous !

Le 17 janvier 1975, la France dépénalise l’avortement. Simone Veil, alors ministre de la
santé, défend le texte qui est adopté après de violents débats. A l’occasion des 50 ans de la loi
Veil, la Bpi vous propose une sélection de ressources numériques sur le droit à l’avortement, ses évolutions
et son influence, sous un éclairage juridique, sociologique et médical.
Certaines ressources sont accessibles à distance après création d’un compte à la bibliothèque. Pour plus d’infos sur comment y accéder depuis chez vous, consultez la page Nos ressources à distance !
Les lois Veil : Contraception 1974, IVG 1975
Les lois Veil, l’une en 1974 sur la contraception et l’autre en 1975 sur l’IVG, sont à compter parmi les événements fondateurs de l’histoire du XXe siècle. Cet ouvrage en reconstitue la généalogie depuis la fin du XIXe siècle où s’ébauchent les politiques de répression.
Ressource accessible à distance !
Sociologie de l’avortement
À l’heure où l’avortement fait l’objet de violentes controverses dans de nombreux pays, l’ambition de cet ouvrage est d’interroger les idées reçues sur l’interruption de grossesse et de rendre compte de l’important corpus de connaissances produites sur le sujet par les sciences sociales.
Nous l’avons fait : récit d’une libération féministe
De septembre 1973 à juin 1980, Annie Chemla nous livre le journal d’une militante du Mlac (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), qui, même après la loi Veil dépénalisant l’avortement en janvier 1975, continue la lutte.
La vie intime des femmes
Conçu pour accompagner chaque femme, quels que soient son âge et ses convictions, tout au long de sa vie, de la puberté à l’après-ménopause, ce livre répond de façon claire, détaillée et rassurante à toutes les questions qu’elle se pose quand survient un événement particulier ou une inquiétude.
Penser les droits de la naissance
Quelle est ta signification juridique du désormais célèbre arrêt Perruche ? La légalisation de l’avortement n’a-t-elle pas introduit une rupture définitive, dont nous n’avons pas encore pris la mesure, dans la problématisation des normes juridiques et morales susceptibles d’encadrer l’acte exorbitant de naître et de faire naître ? Quels sont les problèmes moraux que pose cette nouvelle culture de la procréation ? Que signifie l’accusation devenue assez courante d’eugénisme ? Est-il nécessaire de repenser les rapports juridiques des femmes aux enfants qu’elles font naître ? Penser les droits de la naissance est une exploration problématique de l’ensemble de ces questions à travers l’axe d’analyse révélé par l’affaire Perruche, devenue en quelque sorte symbole des tensions et des difficultés qui grèvent le futur du droit de la procréation.
Simone Veil, mon héroïne
Dans ce texte lapidaire, Leïla Slimani rend hommage au parcours de Simone Veil, à ses combats, à son engagement. Illustré par Pascal Lemaître, ce texte est fort, bouleversant. L’ensemble constitue un très bel objet à offrir et à s’offrir, pour ne pas oublier
Ressource accessible à distance !
« Notre ventre, leur loi ! » Le Mouvement de Libération des Femmes de Genève
À la fin des années 60, une vague de féminisme déferle sur l’Occident. Des États-Unis en passant par le Japon et l’Europe, des femmes au verbe radical réclament l’égalité sociale avec les hommes. À coup de slogans et de cris dans les mégaphones, elles exigent la révolution et se moquent de la réforme. La plupart d’entre elles ont été formées par les révoltes de mai 68 et maîtrisent la phraséologie marxiste. Ces mouvements féministes centrent leurs luttes autour du corps féminin et de la sexualité.
Ressource accessible à distance !
Léon Blum et l’émancipation des femmes
On le sait favorable au principe de l’égalité des sexes : il a défendu le droit au travail des femmes ainsi que leur accès à la citoyenneté. Mais bien qu’il ait été le premier à nommer trois femmes sous-secrétaires d’État lors du Front populaire, Léon Blum (1872-1950) n’a pourtant pas réussi à faire inscrire le droit de vote des femmes dans la loi. C’est ce paradoxe qu’analyse Antoine Tarrago en éclairant d’un jour nouveau la vie et la carrière de l’un des plus grands hommes politiques français du XXe siècle.
Nos autres ressources en libre accès
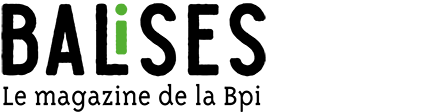
15 jours de plus pour l’IVG ?
Sur Balises, le webmagazine de la Bpi
Tous les ans, d’après une estimation du Planning familial, quatre à cinq mille femmes subissent une interruption volontaire de grossesse (IVG) chirurgicale à l’étranger et à leurs frais, en raison d’un dépassement du délai légal. Une proposition de loi pour allonger ces délais de deux semaines a été rejetée par le Sénat, le 6 janvier 2021. Les associations de défense des femmes ont réclamé un amendement pour étendre exceptionnellement cette durée dans le cadre de l’état d’urgence lié à la pandémie de Covid-19. Il a été également refusé. Mais le délai d’accès à l’IVG est avant tout un problème politique.
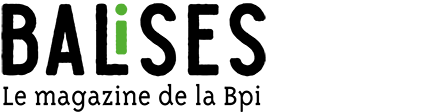
L’avortement et la contraception en France avant la loi Veil
Sur le replay de la Bpi
Une table ronde organisée dans le cadre du premier volet du colloque sur le féminisme consacré à la lutte des années 1970. Le débat portera sur l’avortement et la contraception avant la loi Veil.

Quel est l’état du féminisme aujourd’hui ?
Sur Eurêkoi, le service en ligne de questions-réponses
Pour commencer, reprenons la définition du féminisme d’après le dictionnaire Larousse : « Mouvement militant pour l’amélioration et l’extension du rôle et des droits des femmes dans la société. »
Mais, aujourd’hui, comment ce mouvement se traduit-il en idées et actes ?
Focus sur les combats féministes actuels.
Publié le 03/02/2025 - CC BY-SA 4.0