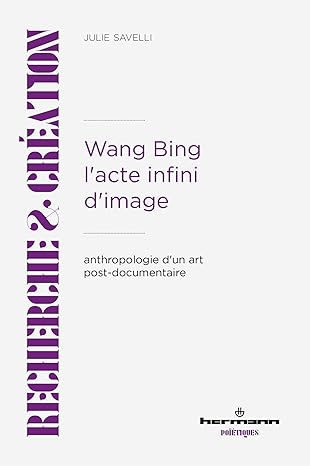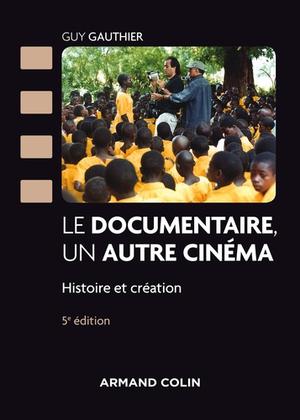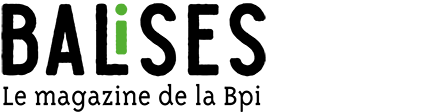Cinéma du réel : notre sélection de ressources à distance
À l’occasion de la 47e édition du festival Cinéma du réel (du 22 au 29 mars), la Bpi vous propose une sélection de ressources numériques accessibles depuis chez vous !

Tandis que le Centre Pompidou ferme peu à peu ses portes pour 5 ans, la 47e édition du festival Cinéma du réel prend ses quartiers Rive gauche, entre Saint-Germain-des-Prés et le Quartier latin, accueilli par quatre salles indépendantes, véritables institutions de la cinéphilie parisienne.
Cette année, pour entrer en résonance avec le chaos du monde et répondre à la question “Quel horizon en l’absence de perspective ?”, le Cinéma du réel convie 4 cinéastes : Wang Bing, Ghassan Salhab, Ryusuke Hamaguchi et Julia Loktev. Découvrez dès à présent une sélection de ressources autour de leurs œuvres !
Ces ressources sont accessibles à distance après création d’un compte à la bibliothèque. Pour plus d’infos sur comment y accéder depuis chez vous, consultez la page Nos ressources à distance !
Wang Bing. L’acte infini d’image Anthropologie d’un art post-documentaire
Depuis près de vingt ans, l’artiste chinois Wang Bing témoigne d’une œuvre rhizomatique (processualité, variabilité, performativité) située à l’intersection du cinéma et de l’art contemporain. Pour saisir la singularité de sa production (film, installation, œuvre vidéo), l’auteure s’attache à éclairer la conduite de création de Wang Bing dans une démarche poïétique et anthropologique qui prend acte du tournant artistique de la création documentaire. Les pratiques du XXIe siècle connaissent en effet un élan qui se manifeste par une hybridation et un élargissement, mais aussi par un regain d’engagement qui érige l’artiste en sujet historique et politique. Dans cet essai, il s’agit donc d’envisager en quoi les modes d’existences résultant de ce terrain socio-génétique sont constitutifs de l’acte d’image « post-documentaire » de Wang Bing.
L’homme sans nom, ou la singularité esseulée
L’homme sans nom habite une cavité rocheuse, quelque part dans la campagne du Hebei, au nord de Pékin. Il vit seul, en autarcie, dans cette région désertée. Cet homme qui ne dit pas son nom ne communique pas, ne communique plus, même face à la caméra de Wang Bing qui filme ses gestes, ses déplacements, ses activités. L’homme sans nom a lâché le langage comme il a lâché toute appartenance ou inscription sociale. L’étrange singularité de son esseulement et de son mutisme surprend le spectateur comme elle a surpris Wang Bing ; elle nous donne à voir la proposition d’une forme de vie, dont je suggère ici une interprétation anthropologique possible, à travers les notions d’indifférence et de contact, en questionnant le choix radical de l’abandon de la communication et par conséquent du système de relations qui lui est lié, abandon par lequel est rendue possible l’émergence d’un tout autre monde dont je tente de tracer un contour.
Wang Bing, cinéaste de la durée
Dans ses documentaires, Wang Bing développe un rapport au temps très particulier. L’article propose quelques pistes de réflexion sur la question de la durée dans l’œuvre du cinéaste chinois en analysant sa façon de filmer et de choisir ses sujets. Il se penche sur quatre films qui documentent des aspects de la Chine contemporaine tout en induisant fortement le sentiment de la durée chez le spectateur. On cherchera ici à comprendre la pratique cinématographique de Wang Bing en regard de la définition de Tarkovski d’un cinéma qui « sculpte dans le temps » : il s’agira alors de saisir le rapport du cinéaste chinois avec le cinéaste soviétique dont il dit s’inspirer.
Ghassan Salhab, le malaise d’une génération
« Personne mieux que Ghassan Salhab n’a décrit, film après film, le mal-être des jeunes Libanais après dix-sept ans de guerre.»
Rencontre et ébranlement
S’il n’a pas bénéficié directement de l’enseignement universitaire de Hasumi Shiguéhiko, Hamaguchi Ryūsuke a été profondément marqué par la lecture de deux de ses textes : Yasujirô Ozu et « Puissance de la parole », consacré à Mizoguchi Kenji. À travers leur analyse, mêlée de souvenirs personnels, Hamaguchi revient à la fois sur la spécificité de la démarche hasumienne, et sur sa vision du cinéma et de la critique.
Deux fois le mystère du terrorisme
C’est au moment où des milliers de festivaliers s’apprêtent à gagner l’aéroport de Nice pour rentrer chez eux que le Festival leur propose de découvrir Vol 93, de Paul Greengrass. Cette relation minutieuse du détournement, le 11 septembre 2001, d’un avion de United Airlines, et de la révolte de ses passagers contre les terroristes est projetée le même jour que Day Night, Day Night, le premier film de l’Américaine née en Russie Julia Loktev, qui suit les pas d’une jeune femme en passe de faire sauter les explosifs dont elle est ceinte sur Times Square, à New York.
Le documentaire, un autre cinéma
Le documentaire est un style à part, né loin des studios avec le développement des caméras légères. De Robert Flaherty à Raymond Depardon, les noms qui jalonnent son histoire témoignent de sa participation active à l’élaboration et au développement du langage cinématographique. Cet ouvrage est depuis longtemps la référence de l’étudiant comme du cinéphile. Du cinéma muet à l’image numérique, il retrace l’histoire de cet « autre cinéma » à travers les continents, en analysant son esthétique originale et sa confrontation au réel. À l’occasion de cette cinquième édition, les biographies et les filmographies de cinéastes majeurs ont été actualisées, et deux études ajoutées, consacrées aux récents National Gallery de Frederick Wiseman et À la recherche de Vivian Maier de John Maloof et Charlie Siskel.
Nos autres ressources en libre accès
Un désir de cinéma : La question de l’engagement
Dans le champ de l’industrie cinématographique, le documentaire est marginal. C’est de cette marginalité qu’il tire à la fois sa difficulté à exister (tant économiquement que socialement) mais aussi sa liberté. Liberté à interroger nos soumissions et de nos révoltes dans le monde réel. Dans ce contexte, quelle place singulière le documentariste revendique t-il et quelles histoires a-t-il à raconter ? Et s’il s’agit de résister à quoi résiste t-il et comment ? L’engagement du cinéaste documentariste ne peut être seulement politique, il se traduit par une démarche et des manières de faire qui lui permettent de contrer tout à la fois la propagande, les idées reçues et la fiction de la réalité.
Où trouver des films documentaires et des reportages en français sous-titrés en arabe ou en arabe sous-titrés en français ?
Moins fréquemment recommandé que les films de fiction ou les séries pour progresser en langue, le cinéma documentaire peut pourtant également constituer une ressource intéressante, et ce d’autant plus qu’il porte sur des sujets d’actualité ou de culture, qui éclairent notre compréhension du monde.
Voici quelques suggestions de films documentaires sur des sujets historiques, sociaux ou politiques disponibles à la bibliothèque de l’IMA.
Publié le 20/03/2025 - CC BY-SA 4.0