La « grande démission » : mythe ou réalité ?
Notre sélection de ressources
Du 10 janvier au 7 mars, la Bpi vous propose une sélection de ressources ainsi qu’une bibliographie sur les enjeux actuels du marché de l’emploi.
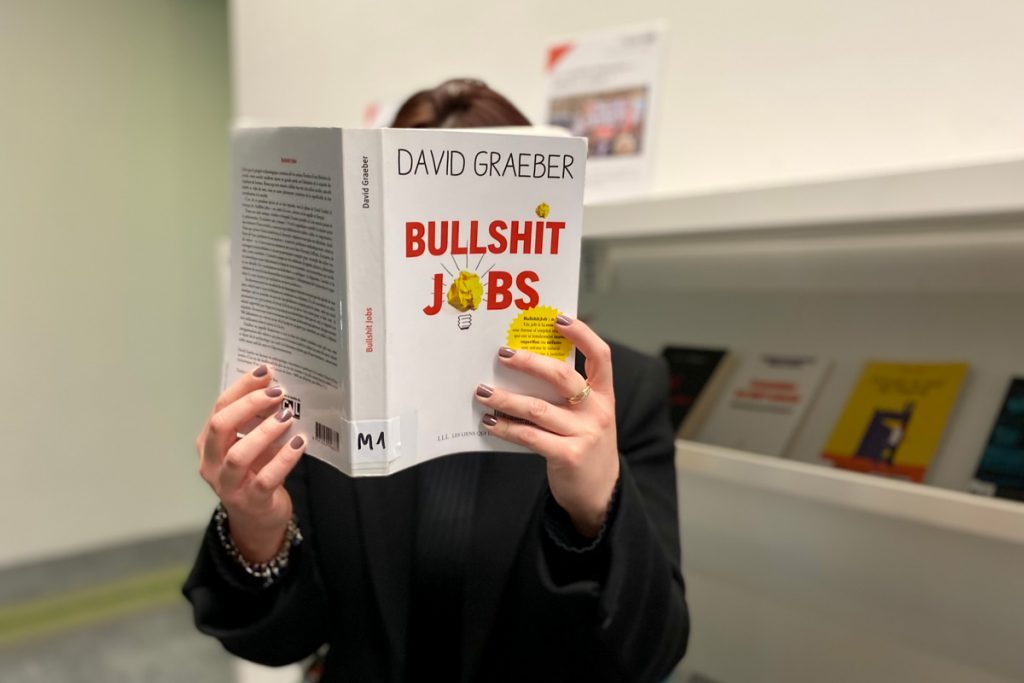
Le spectre d’une « grande démission » hante le marché de l’emploi en France. Mais d’où provient cette expression qu’on entend de plus en plus souvent dans les médias, et quelle réalité recouvre-t-elle ? Le phénomène du big quit désigne une importante vague de démissions qui a eu lieu aux États-Unis pendant la pandémie de covid-19. En effet, plus de 38 millions d’américain-e-s ont quitté leur emploi en 2021 (sur 162 millions d’emplois). Un chiffre d’autant plus impressionnant que 40% des démissionnaires n’avaient pas encore trouvé de nouvel emploi lorsqu’ils ont quitté leur poste ! Le secteur tertiaire est le premier concerné, en particulier les emplois mal rémunérés dans l’hôtellerie-restauration, le commerce ou les entreprises de services.
En France, on entend une petite musique similaire : les entreprises peinent à recruter, les Français-e-s « ne veulent plus travailler » ou « ne travaillent pas assez » … Qu’en est-il réellement ? Selon la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), le nombre de démissions est effectivement élevé : plus de 520 000 travailleurs-euses ont quitté leur emploi au 1er trimestre 2022, un chiffre comparable à la période 2008-2009 au plus fort de la crise financière. Pas d’inquiétude, selon la DARES, pour qui ce phénomène est conjoncturel et s’explique par la reprise économique post-covid-19 : « Durant les phases d’expansion économique, de nouvelles opportunités d’emploi apparaissent, incitant à démissionner plus souvent ». Une situation globalement favorable aux salarié-e-s, et qui devraient déboucher sur une hausse généralisée des salaires.
Or, le salaire est la première cause de démission des travailleurs-euses en France. En 2022, les salaires auraient augmenté de 3% en moyenne, une hausse néanmoins imperceptible face la flambée de l’inflation s’élevant à 6,2% sur l’année 20225. Pour gonfler les salaires, les entreprises ont prioritairement eu recours aux dispositifs de salaire variable et aux primes défiscalisées et désocialisées pour le pouvoir d’achat. Il s’agit principalement d’augmentations ponctuelles, ce que dénoncent certain-e-s économistes, car parallèlement le montant des dividendes versés aux actionnaires continue de battre des records. Ces inégalités de revenu alimentent la précarité et engendrent une nouvelle classe de « travailleurs-euses pauvres ». Selon l’Insee, ces personnes qui « occupent un emploi mais sont malgré tout dans un ménage dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté », représenteraient environ 7% de la population active en France. Le traditionnel CDI cède du terrain à la flexibilité néolibérale, prenant la forme de CDD, d’intérim, de temps partiels et d’ubérisation. Ces statuts d’emploi, plus précaires et souvent mal rémunérés, remettent au question le salariat et les droits sociaux qui leur sont associés. Le Parlement européen a d’ailleurs voté lundi 12 décembre en faveur de mesures visant à mieux protéger les travailleurs-euses des plateformes numériques (Uber, Deliveroo, Just Eat, etc.) et à requalifier leur statut d’indépendant face à la présomption de salariat. Par ailleurs, l’Observatoire des inégalités alerte
sur les conditions de travail des travailleurs-euses de première ligne : « une fraction considérable de la force de travail continue à exercer des emplois éprouvants dans des environnements dangereux. Cette pénibilité est très loin d’être reconnue à sa juste valeur – qu’il s’agisse de salaire ou d’estime sociale ».
Dans ces conditions, on s’étonne un peu moins que des métiers difficiles et mal rémunérés n’attirent plus beaucoup de candidats, que ce soit dans le secteur privé (restauration, industrie, construction, etc.) ou le secteur public (enseignement, transports, santé, etc.). Pour une partie des travailleurs-euses, faire carrière ne fait plus rêver et n’est plus une priorité. Cela s’exprime de plusieurs manières : être infidèle à son entreprise, refuser le surinvestissement, ne plus adhérer à la culture d’entreprise, quitte à en faire le minimum… cette attitude, les managers-euses et journalistes la nomment « démission silencieuse ». Pour ses adeptes, il s’agit d’une critique des méthodes managériales visant à « l’épanouissement » ou la « réalisation de soi » au travail. Ces salarié-e-s revendiquent leur droit au détachement, car après tout, s’ils acceptent « de s’activer à la réalisation d’un désir qui n’est primitivement pas le leur », c’est principalement pour remplir le frigo et payer les factures, et non pour donner un sens à leur vie.
La question du sens se pose de façon triviale pour un certain nombre d’emplois que l’anthropologue David Graeber qualifie de bullshit jobs (« boulots à la con »), et qu’il définit ainsi : « un boulot si inutile, absurde, voire néfaste, que même le salarié ne peut en justifier l’existence, bien que le contrat avec son employeur l’oblige à prétendre qu’il existe une utilité à son travail », et de citer en exemple « les consultants RH, les responsables de communication, les avocats d’affaires, les lobbyistes,… ». Des postes bien rémunérés, contrairement à bon nombre de métiers jugés indispensables (enseignant-e-s, aide-soignant-e-s, caissier-ère-s, agent-e-s d’entretien, etc.).
Jusque dans les grandes écoles, des jeunes s’interrogent sur ce modèle de société. Lors de la remise des diplômes 2022 d’AgroParisTech, huit étudiant-e-s ont pris la parole pour exprimer leur prise de conscience : « Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d’être fiers et méritants d’obtenir ce diplôme à l’issue d’une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours »
Les nouvelles générations portent-elle un nouveau regard sur le travail ? Les générations Y et Z font face à des enjeux inédits sur le plan économique, social et climatique, mais leur quête de sens s’inscrit dans une pensée qui a émergé dès les années 1970, à l’instar des travaux de penseurs tels qu’André Gorz, Jacques Ellul ou encore Ivan Illich. Ces auteurs ont inspiré les théories de la décroissance, dénonçant le caractère aliénant du productivisme capitaliste et de l’organisation du travail, et esquissant une vision de la société débarrassée du consumérisme et des injonctions decroissance économique, au service de l’intérêt général et d’activités socialement utiles (incluant le travail « gratuit » : élever des enfants, s’occuper d’un proche, faire du bénévolat, recycler ses déchets, etc.).
La crise sanitaire a rendu plus sensible la répartition entre la part du travail et celle du capital dans la création de valeur, et ce sont les capitaux issus du numérique et des nouvelles technologies qui ont tiré leur épingle du jeu. Est-ce un avant-goût de l’économie du futur ? Quel est l’avenir du travail face à l’automatisation ? Les intelligences artificielles vont-elles remplacer les travailleurs-euses, et devenir elles-mêmes salariées ? Pourront-elles un jour… démissionner ?
Pour aller plus loin sur le sujet, venez consulter notre sélection d’ouvrages et documents disponible du 10 janvier au 7 mars à l’entrée du niveau 2. Vous pouvez également consulter en ligne ou télécharger en PDF une bibliographie réalisée par nos bibliothécaires :
Publié le 10/01/2023 - CC BY-SA 4.0
